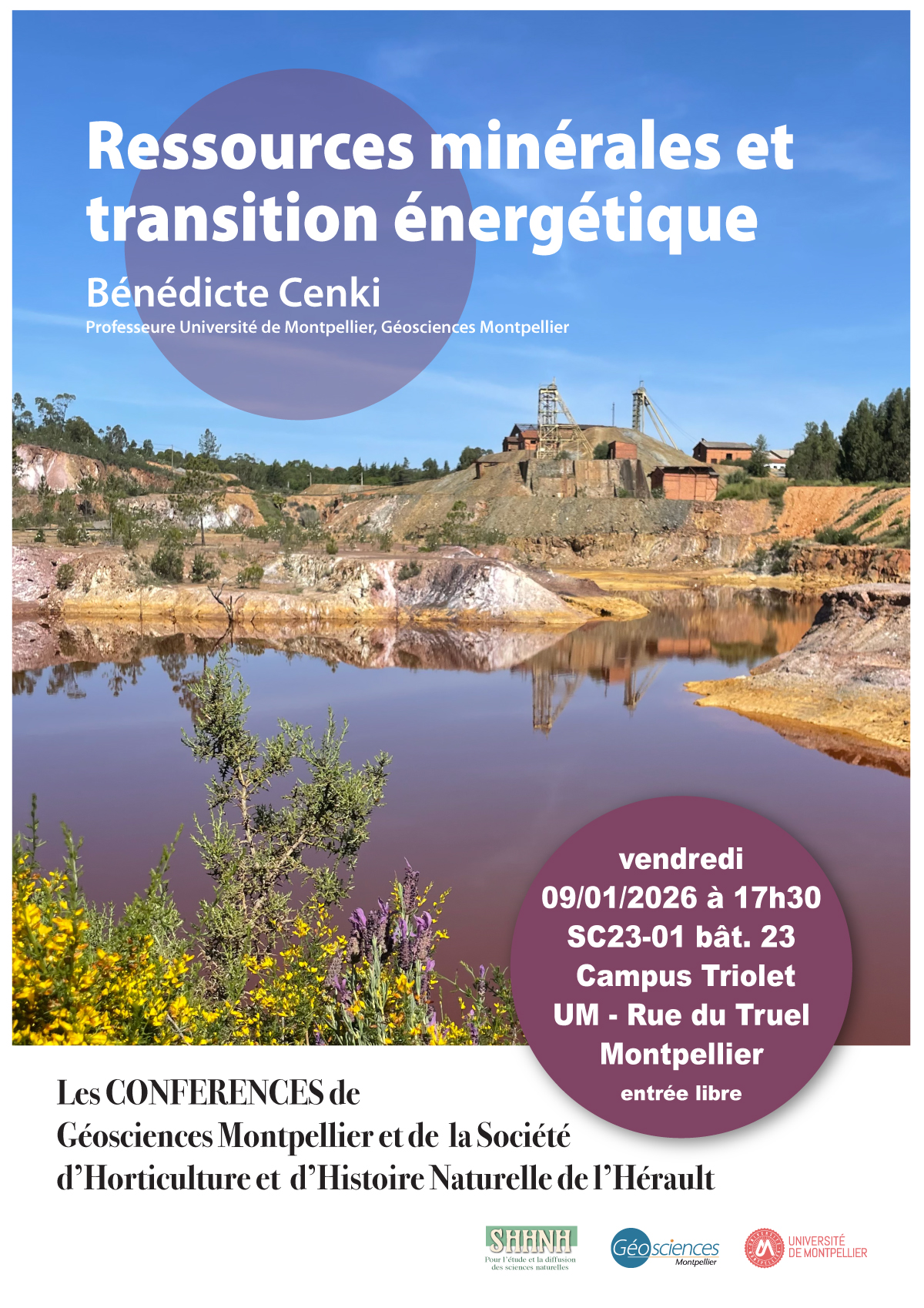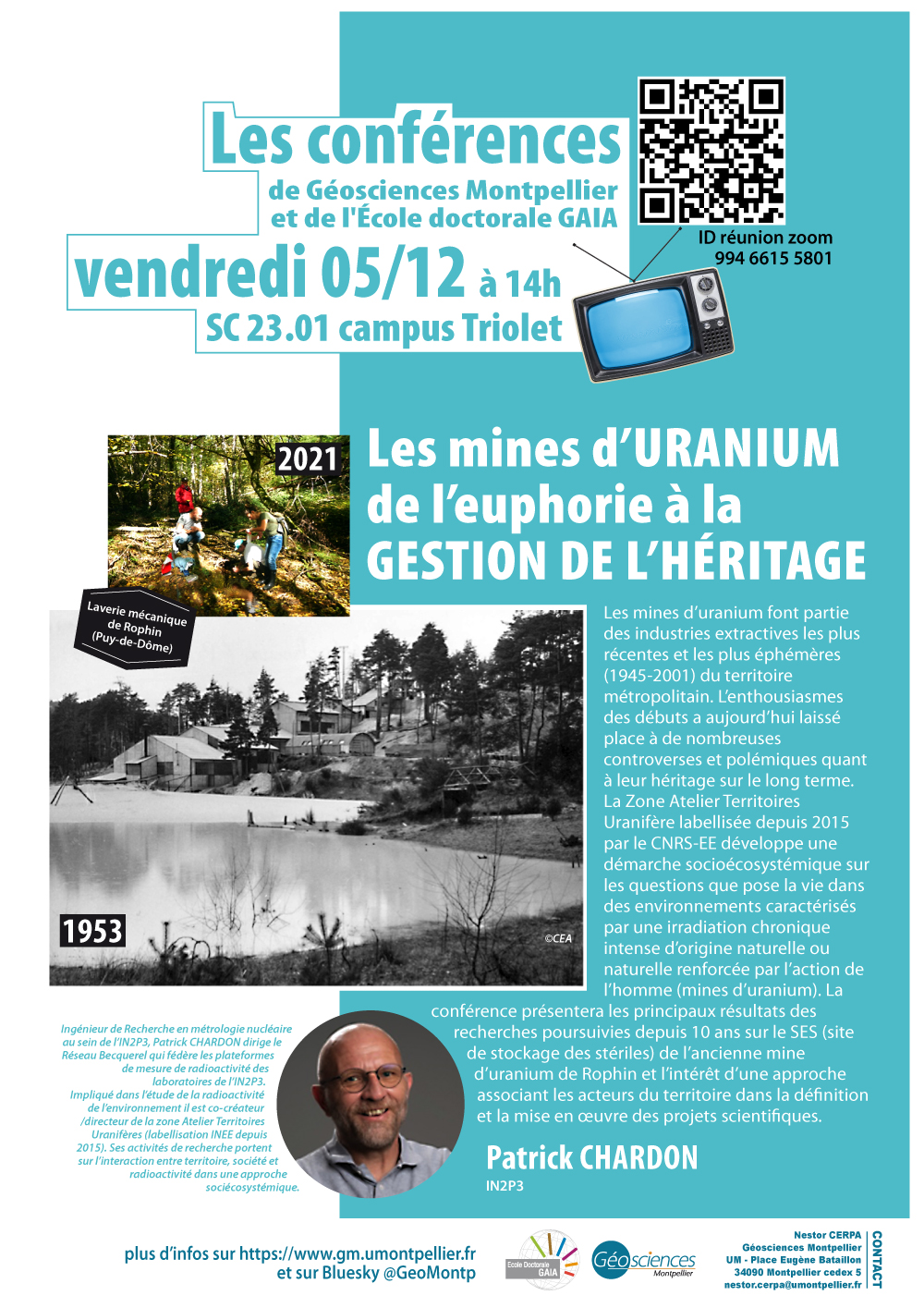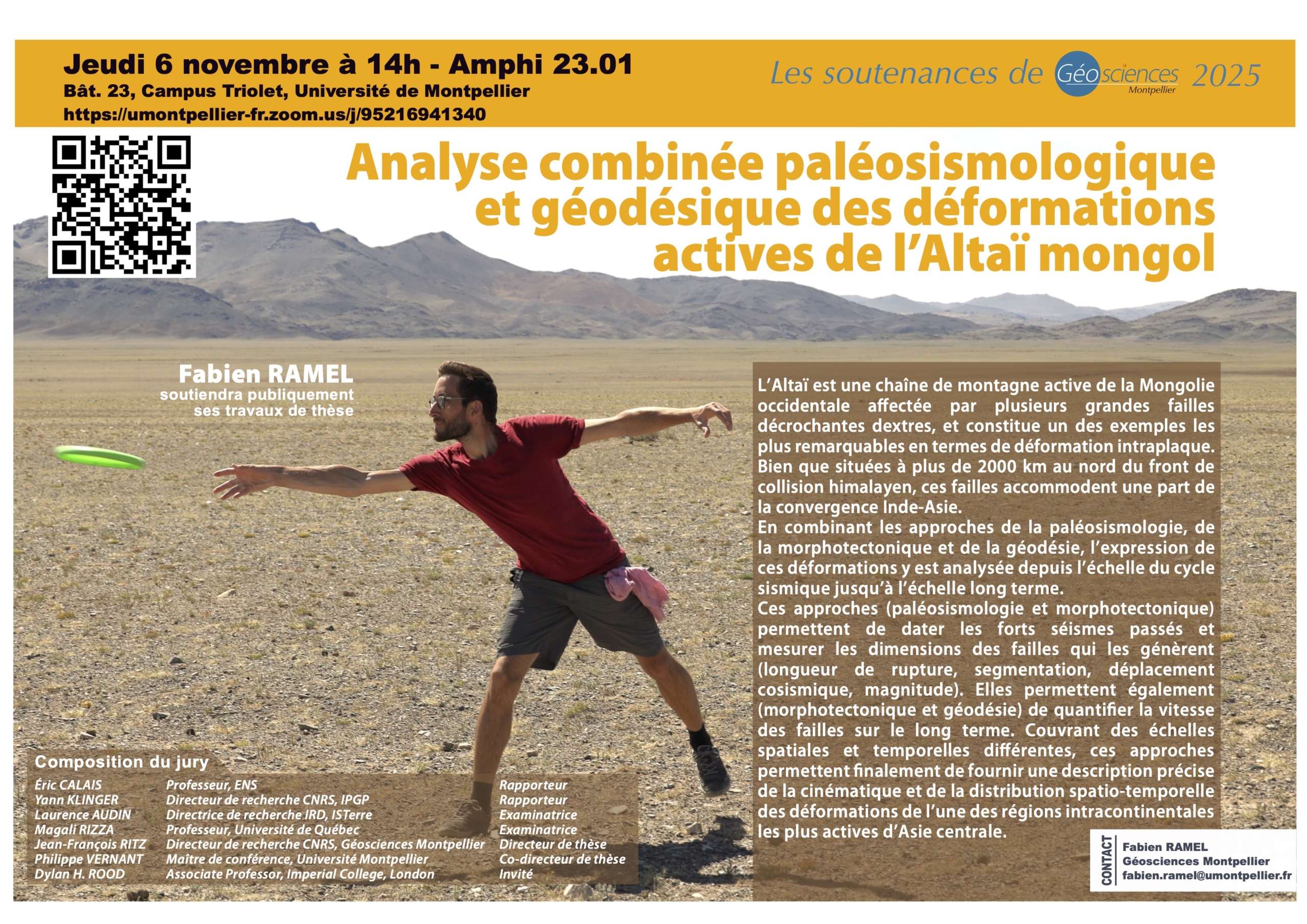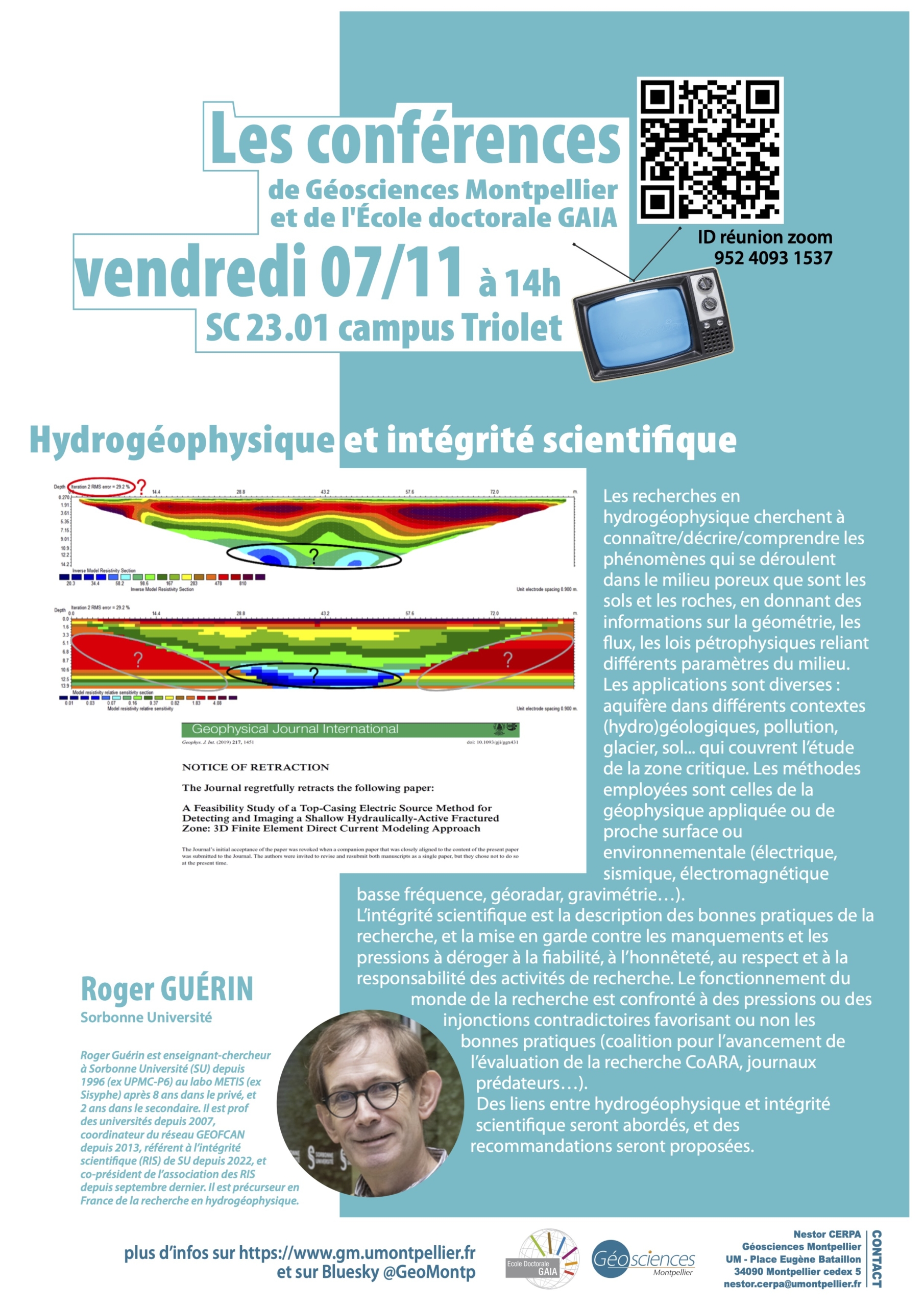Université Montpellier, Campus Triolet, Bâtiment 36, amphi 36.01
Comparaison de filières de traitement d’eau usée pour la recharge d’aquifères
L’eau douce, ressource vitale pour l’humanité, est sous forte pression en raison de la croissance démographique, de l’urbanisation et du changement climatique. Pour préserver cette ressource, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) apparaît comme une solution prometteuse. La France vise ainsi à réutiliser 10 % de ses eaux usées traitées d’ici 2030. Cependant, les stations de traitement des eaux usées (STEU) n’éliminent pas efficacement les micropolluants organiques (MPs), notamment les composés pharmaceutiques, dont la présence à l’état de traces dans les milieux aquatiques soulève des enjeux environnementaux et de santé humaine majeurs. Afin d’assurer une REUT sûre, il est nécessaire d’intégrer des traitements complémentaires dits « quaternaires », exigés par la directive européenne DERU2, qui impose une élimination d’au moins 80 % des MPs prioritaires d’ici 2045.
Dans ce contexte, cette thèse vise à améliorer les connaissances sur les procédés quaternaires appliqués en conditions réalistes, sans dopage en MPs. Trois objectifs ont guidé les travaux : (i) évaluer l’efficacité des procédés avancés pour l’élimination des MPs pharmaceutiques, (ii) étudier leur couplage avec un procédé « low-cost » fondé sur la nature, et (iii) examiner l’apport des approches analytiques non-ciblées pour la caractérisation des traitements. Dans un premier temps, les travaux ont porté sur l’évaluation de l’efficacité de l’ozonation sur une EUT réelle via une approche intégrée combinant analyse ciblée, recherche de suspects et analyse non-ciblée. Les résultats ont montré des éliminations supérieures à 80 % pour la majorité des MPs à des doses d’ozone inférieures à 1,5 gO3.gC⁻¹, mais aussi la formation d’un grand nombre de produits de transformation issus de l’ozonation (OTPs) à faibles doses (< 1 gO3.gC-1), confirmant la pertinence du suivi par approche non-ciblée. La deuxième partie a évalué la nanofiltration (NF) avec une membrane innovante à fibres creuses en couches de polyélectrolytes (dNF40). Les expérimentations, menées sur eau ultrapure et EUT réelle, ont mis en évidence une rétention supérieure à 80 % pour la majorité des MPs et à 70 % pour la matière organique. La membrane a également montré un faible colmatage, une bonne sélectivité et la production d’un concentrat faiblement salin, démontrant son potentiel pour la REUT, sous réserve d’une gestion adaptée des concentrats. Enfin, le couplage entre procédés avancés et le traitement par infiltration (SAT) amélioré par une barrière réactive naturelle, composée de sable, compost et sciure de bois a été étudié. Ce couplage a permis d’améliorer significativement les performances d’élimination, notamment pour les composés biodégradables et/ou chargés positivement.
Ces résultats confirment la complémentarité entre procédés intensifs et solutions « low-cost » fondées sur la nature, ouvrant la voie à des stratégies de REUT durables et économiquement soutenables. L’utilisation d’approches analytiques non-ciblées s’est révélée essentielle pour mieux appréhender la complexité du processus d’ozonation et identifier plusieurs OTPs générés en conditions réalistes. Ce travail contribue ainsi à la mise en place de stratégies de traitement quaternaire efficaces, durables et compatibles avec les objectifs de préservation des ressources en eau.
Mots clés : Réutilisation des eaux usées traitées, Ozonation, Nanofiltration, Barrière réactive, Analyse ciblée et non-ciblée
Composition du Jury :
– Silvia DIAZ CRUZ, Chercheure, IDAEA, CSIC, Rapportrice
– Dominique WOLBERT, Professeur des Université, ISCR, ENSC Rennes, Rapporteur
– Frédérique COURANT, Professeure des Universités, HSM, Université de Montpellier, Examinatrice
– Romain RICHARD, Maitre de conférences, LGC, Université de Toulouse, Examinateur
– Stéphan BROSILLON, Professeur des Universités, IEM, Université de Montpellier, Directeur de thèse
– Linda LUQUOT, Directrice de recherche, GM, CNRS, Co-Directrice de thèse
– Julie MENDRET, Maître de conférences – HDR, IEM, Université de Montpellier, Invité (Co-Encadrante)
– Geoffroy DUPORTE, Maître de conférences, HSM, Université de Montpellier, Invité (Co-Encadrant)