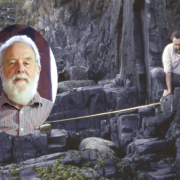[Hommage] Michel Prévot, décédé le 5 novembre 2025
Michel Prévot a consacré sa vie à comprendre le magnétisme des roches volcaniques et, à travers lui, l’histoire du champ magnétique terrestre.
Né à Paris en 1939, il commence sa carrière scientifique en 1965 au CNRS à Saint-Maur, auprès d’Émile Thellier, l’un des pionniers du paléomagnétisme. En 1985, il rejoint Montpellier, où il fonde un nouveau laboratoire de paléomagnétisme — resté longtemps un lieu de référence internationale — et dirige l’équipe jusqu’en 2000, tout en assurant la direction du Centre de Géologie et de Géophysique de 1989 à 1993.
Dès ses premiers travaux, Michel se distingue par une approche à la fois expérimentale et théorique d’une grande finesse. En 1968, il étudie pour la première fois l’oxydation à basse température de la magnétite, montrant que le processus n’est pas une simple réaction d’oxydation, mais qu’il implique une migration d’ions fer et titane dans la structure cristalline (Prévot et al., 1968). Cette découverte, pionnière, conduit à un modèle encore largement accepté aujourd’hui.
Quelques années plus tard, avec P. Poix, il met au point une méthode de calcul des paramètres cristallographiques des titanomagnétites oxydées (Prévot, 1971; Prévot & Poix, 1971), confirmée ultérieurement par des analyses expérimentales.
Dans les années 1970, la compréhension du magnétisme des fonds océaniques devient un enjeu majeur. Michel participe alors au projet franco-américain FAMOUS, consacré à la dorsale médio-atlantique. Ses travaux démontrent que les basaltes formés à l’axe de la dorsale présentent une polarité normale, en accord avec les modèles d’expansion océanique (Prévot et al., 1976).
Avec A. Lecaille, il met également en évidence le rôle déterminant de la pétrologie dans les anomalies magnétiques océaniques (Prévot & Lecaille, 1976a, b; Prévot et al., 1979), puis, en collaboration avec D. Dunlop, il élabore un modèle magnétique de la lithosphère océanique devenu une référence (Dunlop & Prévot, 1982).
Ses travaux sur l’Aimantation Rémanente Visqueuse (ARV) comptent parmi ses contributions les plus marquantes. Avec D. Biquand, il montre dès 1970 que l’ARV des roches sédimentaires et volcaniques peut résister à des champs alternatifs bien plus intenses qu’on ne le pensait (Prévot & Biquand, 1970; Biquand & Prévot, 1971). Cette découverte, longtemps controversée, sera finalement expliquée par la théorie de la viscosité magnétique activée thermiquement dans les grains ayant un comportement de type monodomaine (Prévot, 1981). En collaboration avec M. Bina, il étend ensuite cette approche aux grains poly-domaines, introduisant la notion de volume d’activation des défauts cristallins (Prévot & Bina, 1993; Bina & Prévot, 1994). Ces travaux constituent aujourd’hui un socle fondamental de la physique du magnétisme des roches naturelles.
Sa contribution la plus célèbre reste sans doute l’étude du renversement de polarité du champ magnétique terrestre enregistré dans les basaltes de la Steens Mountain (Oregon), réalisée avec ses collègues de l’USGS à Menlo Park, Californie (Prévot et al., 1985a, b; Mankinen et al., 1985). Ce travail demeure la description la plus complète et la plus fiable d’un renversement du champ géomagnétique. Basée sur un modèle physique théorique impliquant l’hypothèse d’un champ géostrophique dans le noyau liquide, il propose avec P. Camps en 1996, une approche statistique capable de reproduire l’ensemble du spectre des fluctuations du champ magnétique terrestre, de la variation séculaire aux renversements du champ.
Jusqu’à la fin de sa carrière, Michel explore de nouveaux phénomènes : l’auto-inversion de la thermorémanence dans les cristaux de ferri-ilménite (Prévot et al., 2001), ou encore la réévaluation de la vraie dérive du pôle (autrement appelée le basculement de l’axe de rotation de la terre) au cours des 200 derniers millions d’années, qu’il revisite avec rigueur et esprit critique (Prévot et al., 2000).
Chercheur d’une rare exigence intellectuelle, pédagogue attentif et profondément passionné par la Terre et son histoire, Michel a formé plusieurs générations de chercheurs et inspiré de nombreuses vocations. Son héritage scientifique et humain demeure vivant, à Montpellier comme ailleurs, dans les laboratoires et les cœurs de ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés.
Principales références citées
- Bina, M. & Prévot, M. (1994). Thermally activated magnetic viscosity in natural multidomain titanomagnetite. Geophys. J. Int., 117, 495–510.
- Biquand, D. & Prévot, M. (1971). A.F. Demagnetization of viscous remanent magnetization in rocks. Z. Geophys., 37, 471–485.
- Camps, P. & Prévot, M. (1996). A statistical model of the fluctuations in the geomagnetic field from paleosecular variation to reversal, Science, vol. 273, pp. 776- 779, 1996.
- Dunlop, D. J. & Prévot, M. (1982). Magnetic properties and opaque mineralogy of drilled submarine intrusive rocks. Geophys. J. R. Astron. Soc., 69, 763–802.
- Mankinen, E. A., Prévot, M., Grommé, C. S. & Coe, R. S. (1985). The Steens Mountain (Oregon) geomagnetic polarity transition. I. Directional history, duration of episodes and rock magnetism. J. Geophys. Res., 90, 10,393–10,416.
- Prévot, M. (1971). A method for identifying naturally occurring titanomagnetites. Z. Geophys., 37, 339–347.
- Prévot, M. (1981). Some aspects of magnetic viscosity in subaerial and submarine volcanic rocks. Geophys. J. R. Astron. Soc., 66, 169–192.
- Prévot, M. & Biquand, D. (1970). Sur la plus ou moins grande résistance de l’aimantation rémanente visqueuse. C. R. Acad. Sci. Paris, 270, 1365–1368.
- Prévot, M. & Poix, P. (1971). Un calcul du paramètre cristallin des titanomagnétites oxydées. J. Geomag. Geoelectr., 23, 255–265.
- Prévot, M. & Lecaille, A. (1976a, b). Sur le caractère épisodique du fonctionnement des zones d’accrétion… Bull. Soc. Géol. Fr., 18, 903–911.
- Prévot, M., Lecaille, A., Francheteau, J. & Hekinian, R. (1976). Magnetic inclination of basaltic lavas from the Mid-Atlantic Ridge near 37°N. Nature, 259, 649–653.
- Prévot, M., Lecaille, A. & Hekinian, R. (1979). Magnetism of the Mid-Atlantic Ridge crest near 37°N… Maurice Ewing Series, AGU, 2, 210–229.
- Prévot, M., Mankinen, E. A., Coe, R. S. & Grommé, C. S. (1985a, b). How the geomagnetic field vector reverses polarity; Field intensity variations… Nature, 316, 230–234; J. Geophys. Res., 90, 10,417–10,448.
- Prévot, M., Mattern, E., Camps, P. & Daignières, M. (2000). Evidence for a 20° tilting of the Earth’s rotation axis 110 million years ago. Earth Planet. Sci. Lett., 179, 517–528.
- Prévot, M., Hoffman, K. A., Goguitchaichvili, A. et al. (2001). The mechanism of self-reversal of thermoremanence in natural hemoilmenite crystals. Phys. Earth Planet. Inter., 126, 75–92.
- Prévot, M., Rémond, G. & Caye, R. (1968). Étude de la transformation d’une titanomagnétite en titanomaghémite dans une roche volcanique. Bull. Soc. Fr. Minér. Cristallogr., 91, 65–74.